Une atmosphère post-apocalyptique dans l’est de la France… Incident nucléaire ? Quarantaine ? Pour son premier roman, Thomas Flahaut questionne notre société, nos modes de vie et interroge l’avenir à l’aune d’un monde finissant. Ambitieux et déroutant.
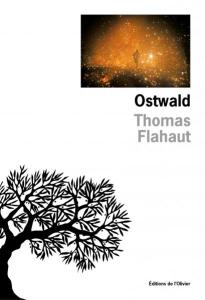
« Comment ça meurt une ville ? » A quoi on pourrait ajouter comment ça meurt un monde ? Ambiance de fin du monde dans ce premier roman étonnant. On débute avec une famille ouvrière en proie avec la fermeture d’une usine, les conséquences désastreuses pour l’équilibre du foyer, la vie économique d’une ville, d’un pays, le chômage des enfants… Puis on continue avec une histoire d’amour à trois, une jalouse complicité entre deux frères, une femme envoûtante, libre, insaisissable… Et le drame, prévisible, survient : l’incendie d’une réacteur nucléaire à la centrale de Fessenheim. Noël raconte à demi-mots, en suspends, en ellipses : un père mystérieux, des parents séparés, sa réserve encombrante, son regard sur son pays, sa ville et comment dans cet univers industriel, qui court à sa perte, il navigue ou flotte à vue sans réellement se projeter vers un avenir dont il ne nous dit aucun désir… En a-t-il seulement ? « Il fallait pourtant vivre, et pour Félix et moi grandir, près d’un cadavre sans odeur, le squelette rouille et vert-de-gris de l’usine laissé là, pourrissant lentement au milieu de Belfort, comme un fantôme du passé ou un avant-goût de l’avenir. » L’évacuation forcée de toute une région en alerte face au danger nucléaire déclenche un exil et une errance dans une atmosphère apocalyptique. Des inhumanités que les hommes n’ont de cesse de démontrer depuis toujours, et toujours les vilenies qui se multiplient quand la terreur et l’inconnu prennent le pouvoir. En cela l’auteur ne nous apprend malheureusement rien. Cependant son roman est novateur en ne choisissant pas de décortiquer le périclite d’une usine, d’une société, d’un mode de vie mais en rédigeant la suite futuriste, proche, d’une transition à opérer qui ne semble pas pouvoir se réaliser sans destruction. Ostwald plus qu’une ville porte le nom d’un âge, d’une époque, que semble incarner le père, lequel en disparaissant laisse peut-être la place à une nouvelle génération, qu’il inviterait dès lors à se réinventer loin, très loin des systèmes connus et répétés depuis ces dernières décennies, très loin du monde qu’il aura défendu et donc imposé à ses fils. Lui aussi s’évanouit dans la nature brumeuse, peut-être soulagé d’offrir une chance au nouveau à construire… « Il y a quelques jours, assis sur le banc étroit d’un camion militaire, au milieu d’autres gens qui emportaient aussi peu de choses que lui, papa a dû se dire que dans tout ce chaos nous ne nous reverrions plus, que le temps était venu de nous laisser tranquilles. Et il était heureux, peut-être, alors que le tourbillon du monde l’emportait loin d’Ostwald. » C’est sombre, réaliste, road-movie ouvrier sur une terre abandonnée. Les images sont belles pour décrire l’effondrement des institutions, des fondations comme des longs travellings nocturnes entre brouillards et feux incandescents… Premier roman comme une promesse. – Karine Le Nagard
______________________
Il y a d’abord Noël, son frère Félix et Marie, trois personnages en quête de reconnaissance, qui tentent de trouver un sens à leur vie, et puis il y a le monde du dehors, artificiel et sclérosé, juxtaposition d’individualités où le lien social se délite indéfectiblement. Lorsque survient la catastrophe nucléaire, la société implose, le cadre vole en éclat, la loi du plus fort prévaut, survivre devient le but ultime, mais à quel prix dans des villes fantomatiques vidées de leurs habitants ? Dans ce premier roman dont la tonalité sombre n’est pas sans rappeler l’excellent Dans la forêt de Jean Hegland, Thomas Flahaut nous convoque au crépuscule d’un modèle économique qui a fait son temps, au basculement irrépressible dans un monde déshumanisé où l’homme est un loup pour l’homme, y compris dans ses rapports familiaux. Si le pessimisme l’emporte dans le chaos environnant la fuite des deux frères ; la porte n’est, me semble-t-il, cependant pas définitivement fermée à une autre issue où un espoir perdure, et en cela ce roman social, nerveux et percutant joue parfaitement sa partition de catalyseur de nos angoisses face à un avenir incertain. A lire d’urgence pour (ré)agir, ne plus subir les diktats qui nous sont imposés, et reprendre notre destin en main, avec courage et discernement… – Catherine Pautigny
________________________
Un scénario catastrophe revisité de manière plutôt originale, qui évite les clichés habituels : pas de grand spectacle, pas de vision de fin de monde… L’accident nucléaire est mis à distance et vécu à travers les points de vue des membres d’une famille éclatée : une mère, un père et surtout deux frères ; autour d’eux gravitent quelques personnages, une petite amie, un clochard, d’autres habitants évacués, des militaires…
Quelques incendies, quelques exactions, quelques scènes surréalistes… C’est plutôt sobre, stylisé à grands traits. La psychologie des protagonistes est travaillée mais pas uniquement par rapport au dysfonctionnement de la centrale nucléaire et à ses conséquences : les souvenirs les accompagnent et prennent souvent le pas sur l’actualité. C’est la fin d’une culture ouvrière après les conflits sociaux de la société Alstom, à Belfort : paradoxalement ces évènements passés servent de lointaine toile de fond.
La question du lieu est omniprésente : la ville d’Ostwald symbolise un point d’ancrage où il faut revenir, un but illusoire, mais un projet, même fragile. le Parlement Européen de Strasbourg perd toute crédibilité et influence ; le bâtiment évacué devient un lieu interlope dénué de sens citoyen mais lourd du délitement de toute une région.
L’écriture est efficace, factuelle, brute, mais jamais brutale. Ce roman se lit facilement, vite, dans l’urgence… La problématique est simple : en cas de catastrophe majeure, il y a une procédure, un plan… Mais, dans une démocratie, il existe « le droit pour tout le monde de s’enfuir ». Ce roman m’a interpelée : comment réagirais-je dans une situation similaire ? Comment vivrais-je l’évacuation rapide avec un minimum de bagages, la promiscuité des camps d’hébergement, l’éventuelle séparation de mes proches ? Comment analyserais-je le manque d’information, l’incertitude sur l’avenir ?
Même dans cette ambiance angoissante de catastrophe nucléaire, les personnages principaux ne parviennent pas à établir de véritable communication entre eux, à se rapprocher vraiment, à aller à l’essentiel ; leur profonde solitude est frappante.
Dans ce roman, l’écriture est à la première personne : ce JE pourrait être le mien, le vôtre, le nôtre… C’est un JE ancré dans le présent, sans recul, sans devenir. Alors oui, je vais peut-être me démarquer, mais ce premier roman de Thomas Flahaut me parle, même s’il me laisse avec mes questions : à la place de ses personnages, où irais-je ? Où serait mon Otswald à moi ?
Un premier roman prometteur que je recommande. – Aline Raynaud
______________________
Lire également les billets des lecteurs directement sur leurs blogs respectifs : Sara a trouvé du charme à ce récit « perturbant et un peu lunaire », Bénédicte le qualifie de brillant, dérangeant mais nécessaire, « un rappel à la vigilance » bienvenu pour Henri-Charles, « une fable contemporaine qui interroge » pour Sabine, « sombre et plombant » pour Héliéna, « un rendez-vous raté » pour Joëlle,


Laisser un commentaire